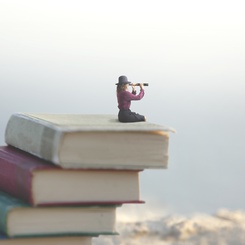Alors que le monde peinait à revenir à la normale après le COVID, certaines personnes, pourtant, semblaient tout avoir. Leur journée pouvait commencer par un jogging sur une plage tropicale, suivi d’un petit-déjeuner dans un café pittoresque. Ils travaillaient au bord d’une piscine, un verre à la main, et admiraient des couchers de soleil grandioses. Il semblait que tout ce dont ils avaient besoin, c’était d’une connexion Wi-Fi fiable, de leur ordinateur portable et d’horaires flexibles. On a pu penser que l’avenir professionnel s’annonçait radieux pour ces nomades digitaux. Srividya Jandhyala, professeure de management à l'ESSEC et auteure du livre "The Great Disruption : How Geopolitics is Changing Companies, Managers, and Work" analyse le lien entre la géopolitique et le futur du travail.
Si la main-d’œuvre du futur sera peut-être différente de celle que nous avons connue jusqu’alors, ce ne sera probablement pas dans le sens que l’on imagine. La montée des tensions géopolitiques fait du nomade digital un mirage pour la majorité. Une autre réalité se dessine, influençant à la fois qui travaille, où l’on peut travailler et comment le travail est effectué.
Qui travaille ?
Avec les tensions géopolitiques croissantes, les entreprises internationales examinent de plus près leurs salariés pour déterminer qui peut travailler sur quels projets. Les restrictions s’accumulent lorsqu’il s’agit de définir qui peut travailler sur des projets clés, quels profils peuvent être recrutés, ainsi que l’accès aux données sensibles au sein même des entreprises.
Aux États-Unis, par exemple, les étudiants chinois font face à une surveillance accrue. Dans la Silicon Valley, les entreprises technologiques renforcent leurs procédures de sécurité pour éviter les fuites d’informations commerciales et les actes d’espionnage. Parallèlement, les guerres commerciales récemment déclarées bouleversent l’ensemble du marché du travail. Le Straits Times de Singapour rapportait que la banque centrale s’inquiétait des répercussions potentielles des tensions commerciales sur l’emploi national. À mesure que la production et les exportations des usines asiatiques ralentissent, des millions d’emplois sont menacés – en Asie comme ailleurs. Les ouvriers thaïlandais produisant des cellules photovoltaïques, par exemple, subissent de plein fouet la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le New York Times, de son côté, rapporte l’histoire de Jane Hu, une employée de bureau à Shanghai, licenciée lorsque son entreprise s’est retrouvée dans l’incapacité d’importer des machines américaines en raison de la flambée des droits de douane chinois.
La question de « qui travaille » va même jusqu’à atteindre les sommets hiérarchiques des entreprises. C’est le cas chez Momentus, une start-up californienne de transport spatial, valorisée à 1,2 milliard de dollars, qui visait une introduction en bourse. Mauvaise nouvelle, cependant, pour son fondateur et PDG, Mikhail Kokorich : en tant que citoyen russe, il ne pouvait pas consulter les informations techniques concernant les projets de sa propre entreprise, en raison des réglementations américaines sur le contrôle des exportations. Il a donc été contraint de démissionner. De la même manière, une étude récente portant sur plus de 1 000 administrateurs étrangers dans des entreprises chinoises cotées en bourse montre que la détérioration des relations politiques entraîne une augmentation des départs parmi ces administrateurs.
Où le travail peut-il être effectué ?
La principale caractéristique du « nomade digital » était bien entendu l’émancipation du bureau. Si l’on peut travailler de n’importe où, pourquoi ne pas choisir un endroit avec des vues spectaculaires, un coût de vie réduit, ou une communauté accueillante ? Ce rêve s’est brutalement heurté à la réalité. Non seulement les entreprises rappellent leurs employés dans les bureaux, mais elles imposent désormais des restrictions accrues sur les lieux où le travail peut être effectué.
Prenez par exemple l’accès aux données de l’entreprise : de plus en plus de pays imposent des règles de localisation des données, interdisant leur transfert au-delà des frontières. Ces réglementations visent à protéger les données jugées sensibles pour la sécurité nationale. Elles signifient aussi que vous pourriez ne pas avoir accès aux données de votre entreprise si vous vous trouvez à l’étranger. Ainsi, des équipes internationales, au sein d’une même entreprise multinationale, peuvent être incapables de collaborer, car elles ne peuvent pas accéder aux données stockées sur des serveurs étrangers. Les entreprises sont donc contraintes de recruter des équipes locales, isolées les unes des autres, et de renoncer aux économies d’échelle internationales.
Prenons l’exemple de TikTok dans l’UE : l’entreprise a été sanctionnée pour avoir stocké les données de certains utilisateurs européens sur des serveurs situés en Chine. D’autres entreprises s’adaptent à ce contexte. Morgan Stanley, par exemple, a relocalisé 200 développeurs technologiques en dehors de la Chine continentale après un durcissement des règles d’accès aux données.
Le rêve d’un Internet global, unifié et sans frontières, se heurte à la réalité géopolitique de la souveraineté numérique.
Comment le travail est-il effectué ?
Le nomade digital incarnait aussi un travailleur au périmètre bien défini, capable de se coordonner facilement avec ses collègues à l’aide d’outils numériques. Néanmoins, ces deux hypothèses sont elles aussi fragilisées par le contexte géopolitique actuel.
La raison est simple : la plupart des dirigeants actuels ont été formés à une époque où la géopolitique n’était pas un obstacle. Ils ont arpenté les écoles de commerce pour étudier l’économie, les états financiers, l’analyse des investissements, la vente à d’anciens ou nouveaux clients, ou la gestion d’équipes multiculturelles. Très peu ont été formés à naviguer dans un monde en mutation, dominé par de puissantes forces politiques. Aujourd’hui, plongés dans ce nouvel environnement, ils doivent improviser.
Certaines entreprises mettent en place de véritables cellules de crise pour suivre les évolutions du monde et proposer des scénarios d’action cohérents à leur direction. Cela détourne cependant les employés de leurs fonctions habituelles. La tâche n’est, par ailleurs, pas plus simple pour les cadres supérieurs, qui doivent désormais gérer l’évolution des gouvernements et des politiques publiques, en plus de leurs clients, salariés et opérations quotidiennes. L’industrie automobile est un bon exemple : aux États-Unis, les constructeurs automobiles font du lobbying pour que soient reconsidérés les droits de douane. En Europe, certains ferment des usines à cause des restrictions chinoises sur les exportations de terres rares. En Chine, les fabricants de véhicules électriques sont poussés à s’autoréguler pour survivre à une guerre des prix féroce.
Le travail managérial exige désormais de nouvelles compétences relationnelles avancées, incluant l’entretien de relations avec des acteurs gouvernementaux, politiques et non gouvernementaux. Or, ce n’est pas un rôle que les nomades digitaux peuvent assumer facilement.
Perspectives
Quand on parle d’avenir du travail, on pense souvent à l’automatisation, à l’intelligence artificielle et au télétravail. Ces éléments vont effectivement transformer notre rapport au travail, mais ils ne racontent pas toute l’histoire. Au-dessus de ces tendances plane une autre force : la géopolitique, qui pourrait bien être le facteur déterminant dans la façon dont ces tendances évolueront.
Pour en savoir plus :

The Great Disruption: How Geopolitics is Changing Companies, Managers, and Work (Cambridge University Press, 2025), best-seller numéro 1 sur Amazon.com.