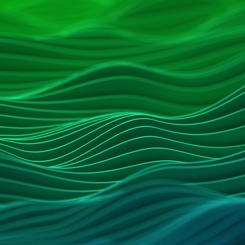Avec ESSEC Knowledge Editor-in-chief
Les taux d’intérêt bas sont-ils toujours une bonne chose ? Si vous êtes propriétaire d’un logement avec un prêt, votre réponse sera sans doute “oui” ! Mais si l’on adopte une perspective plus macroéconomique et que l’on s’interroge sur la manière dont ces faibles taux d’intérêt influencent l’allocation du capital, la réponse devient vite bien plus nuancée. Or ce scénario s’est justement concrétisé au cours des dernières décennies, lorsque les pays d’Europe du Sud ont rejoint la zone euro et ont eu accès à des crédits à faible coût. Les décideurs politiques ont d’abord affirmé que cela stimulerait l’investissement et la croissance. Cependant, si les banques ne parviennent pas à distinguer les emprunteurs productifs des improductifs, cette logique ne tient plus, comme on l’a vu en Europe du Sud : des entreprises peu productives ont obtenu des financements, parfois au détriment de sociétés plus prometteuses, freinant ainsi la croissance à long terme.
Pour mieux comprendre cette relation complexe, Anastasios Dosis, professeur d’économie à l’ESSEC Business School, a étudié le lien entre taux d’intérêt bas, mauvaise allocation du capital et bien-être économique dans un article récemment publié dans le Journal of International Economics. Il a constaté que des taux d’intérêt faibles sur une période prolongée peuvent en réalité permettre à des entreprises fragiles de survivre au détriment d’entreprises plus robustes, qui auraient pu, dans d’autres circonstances, dynamiser l’économie. En d’autres termes, si l’investissement peut sembler être stimulé à court terme, le bien-être économique global, lui, diminue.
Le professeur Dosis a élaboré un modèle théorique autour d’une petite économie ouverte, comprenant des entrepreneurs (ou entreprises) de différents niveaux de performance. Les « bons » entrepreneurs étaient définis comme ceux ayant plus de chances de générer des rendements positifs. Ces entrepreneurs disposaient d’un certain montant de richesse, qu’ils pouvaient soit investir dans leur propre technologie, soit compléter par un emprunt afin de tirer parti des taux d’intérêt sans risque. Les banques prêtaient à des taux compétitifs, mais souffraient d’un désavantage informationnel, car elles ne pouvaient pas identifier précisément la qualité de leurs emprunteurs. Ainsi, la décision d’accorder un prêt dépendait fortement de la qualité moyenne des demandeurs de crédit.
Son modèle a ainsi révélé que des taux d’intérêt bas permettaient à des entreprises peu productives, qui n’auraient normalement pas obtenu de prêt, de recevoir des liquidités, même si la technologie de leur produit était risquée. Cela a entraîné une réaction en chaîne : les banques ont dû relever progressivement leurs taux de prêt pour compenser ces investissements risqués, forçant les entreprises les plus productives à réduire leurs emprunts et leurs investissements. Autrement dit, le taux d’intérêt sans risque et la richesse des entrepreneurs influencent l’équilibre du crédit. Pour chaque niveau de richesse, il existe un seuil clé de taux d’intérêt : en dessous de ce seuil, toutes les bonnes entreprises et certaines mauvaises empruntent. Le nombre de “mauvais élèves” empruntant, ainsi que le montant emprunté par chacun, dépend de ce taux. À des taux très faibles, toutes les entreprises empruntent. À mesure que les taux augmentent, moins d’entreprises peu productives sollicitent des prêts, car le coût d’opportunité devient plus élevé et leurs projets perdent alors en valeur. Une fois un certain seuil dépassé, seules les entreprises les plus prometteuses empruntent : la qualité moyenne du portefeuille de prêts s’améliore. De cette façon, le taux d’intérêt agit comme un mécanisme de filtrage pour les banques.
Points clés soulevés par l’étude
-
Des taux d’intérêt bas permettent aux entreprises les moins solides de surinvestir, leurs investissements étant indirectement subventionnés par les entreprises plus productives, qui de leur côté sous-investissent.
-
Les taux d’intérêt sans risque peuvent différencier les entreprises productives des entreprises improductives — un point souvent négligé dans la recherche jusqu’à présent.
-
Une hausse modérée des taux peut rendre le crédit plus efficace et améliorer le bien-être économique à long terme.
-
Dans un contexte d’asymétrie de l’information entre banques et emprunteurs, ce type de crédit facile d’accès n’est donc pas toujours bénéfique pour le bien-être collectif, car il permet à des entreprises peu productives de perdurer. Le professeur Dosis souligne ainsi l’existence d’un « taux d’intérêt de renversement du bien-être » : en dessous de ce taux, le crédit devient coûteux pour la société, puisqu’il oriente le capital vers des entreprises inefficaces.
Le professeur Dosis indique que le message essentiel à tirer de ses recherches est que tout investissement n’a pas nécessairement un effet positif. Un accès accru à l’emprunt peut, à long terme, freiner la croissance économique. Il est donc crucial d’identifier un taux d’intérêt qui soit suffisamment bas pour encourager l’investissement, mais assez élevé pour écarter les entreprises les moins à même de véritablement prospérer. Les décideurs publics et les banques centrales doivent veiller à ce que leur objectif ne soit pas seulement de stimuler le volume des prêts, mais aussi de s’assurer que ces prêts profitent aux emprunteurs les plus productifs — sinon, le crédit bon marché risque de nous coûter très cher.
Pour aller plus loin
Dosis, A. (2025). Low interest rates, capital misallocation and welfare.Journal of International Economics, 104096.